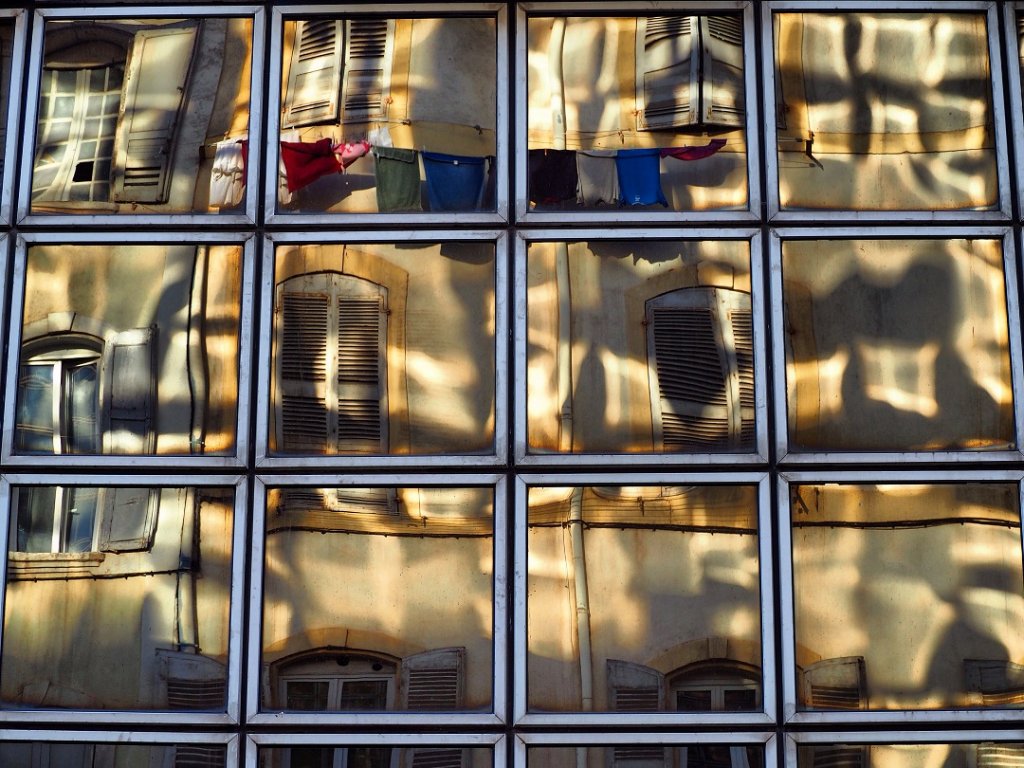Publié le 4 novembre 2025 à 9h05 - Dernière mise à jour le 5 novembre 2025 à 18h45
Depuis le limes de l’Empire romain, les frontières ont toujours fasciné les hommes tandis qu’elles reviennent aujourd’hui plus que jamais sur le devant de la scène internationale. Limites plus ou moins franchissables entre États, espaces et objets de conflits, territoires de coopération, jusqu’à leur effacement en Europe à la faveur de l’entrée en vigueur du Marché unique en janvier 1993, les frontières n’ont cessé d’être un enjeu majeur dans la marche des relations internationales. Pour les passionnés de frontières, l’un de nos voisins méridionaux, l’Espagne, nous offre un véritable cabinet de curiosités frontalières ou les empreintes respectives et conjuguées de l’histoire et de la géographie révèlent une grande diversité, voire complexité, de situations.

Avec la France, 623 kms de coopération transfrontalière émaillés de bizarreries
Courant tout au long des Pyrénées, la frontière franco-espagnole nous offre un très bel exemple de coopération transfrontalière. Que ce soit dans le domaine de la sécurité civile, de la lutte contre-incendie, des liaisons routières ou ferroviaires, autour de l’hôpital transfrontalier de Puigcerda, ou encore dans les 4 centres de coopération policière et douanière (CCPD), cette frontière est devenue un vaste espace d’échanges et de coopération multi-acteurs dont le Traité franco-espagnol signé à Barcelone le 19 janvier 2023, (malheureusement pas encore ratifié par le Congrès des députés de Madrid), consacre le rôle et l’importance dans le cadre plus vaste des relations entre la République française et le Royaume d’Espagne.
Pour autant, l’histoire et la géographie n’en conservent pas moins leurs droits : ainsi en est-il de Llivia, enclave espagnole en France ou exclave de l’Espagne en France. Quoi qu’il en soit, ce micro territoire espagnol (1 500 habitants, 12,8 km²), complètement entouré par le territoire français, est situé dans le Roussillon, à proximité de Bourg Madame et à seulement 1,6 km de l’Espagne à laquelle il est relié, depuis le Traité des Pyrénées de 1659, par une route qui, traversant le territoire français, en permet le libre accès.
Un peu plus loin vers l’Ouest, la Principauté d’Andorre, enclavée entre la France et l’Espagne, a la particularité d’être une Co-Principauté avec deux chefs d’État, le président de la République française et l’évêque espagnol d’Urgell, l’un et l’autre lointains héritiers du « paréage » signé en 1278 entre le Comte de Foix et l’évêque de la Seu d’Urgell. Les deux signataires de cet accord s’étaient érigés alors en « Seigneurs d’Andorre ». Sept siècles plus tard, et après de longues et minutieuses tractations diplomatiques entre Français, Espagnols et Andorrans, la Constitution andorrane est adoptée par référendum le 14 Mars 1993, ouvrant la voie à un accord trilatéral signé le 1er Juin 1993 qui confirme le statut d’Andorre comme État indépendant. Unique Co-Principauté au monde, l’Andorre fera dans la foulée son entrée à l’ONU dont elle deviendra le 184e membre le 28 Juillet 1993.
Toujours en Andorre et forts de notre maîtrise des subtilités entre enclave et exclave, abordons maintenant le cas d’une périclave. Village espagnol de 80 habitants, situé dans la Province de Lleida en Catalogne, la périclave d’Aos de Civis ne peut être rejointe qu’en passant par le territoire de la Co-Principauté d’Andorre en raison du relief montagneux qui ne permet pas d’autre alternative.
En cheminant le long des Pyrénées en direction de l’Atlantique, on tombe enfin sur le fleuve côtier de la Bidassoa. En son milieu, à hauteur d’Hendaye et de Fontarabie, se trouve la petite île des Faisans (130 m de long sur 15 de large). Depuis le Traité de Bayonne de 1856, cet îlot fluvial est un condominium franco-espagnol qui prévoit une souveraineté alternée aux termes de laquelle il est, chaque année, espagnol du 1er février au 31 juillet, puis français du 1er août au 31 janvier.
On le voit, Espagnols et Français n’ont eu de cesse de déployer des trésors de diplomatie et de pragmatisme pour concilier l’histoire partagée (pas toujours simple) et la géographie (souvent compliquée) de leur frontière pour faire de celle-ci un véritable espace de coopération, aujourd’hui à la hauteur des enjeux de leur appartenance commune à l’Union européenne.
Avec le Portugal, « la raya »
La frontière entre l’Espagne et le Portugal, « la raya », (1 215 kms de long) a la particularité d’être la plus ancienne frontière d’Europe, tracée par le Traité d’Alcanices de 1297. L’adhésion simultanée des deux pays à la Communauté économique européenne (CEE) le 1er Janvier 1986 a stimulé la coopération transfrontalière dans de nombreux domaines, notamment autour des trois grands fleuves qui naissent en Espagne avant de pénétrer au Portugal, le Douro, le Tage et le Guadiana. Il en va de même de la coopération économique ou sur le champ de la sécurité civile ainsi que pour les liaisons de transport terrestre. A cet égard, les deux voisins viennent tout juste de s’accorder sur un projet ferroviaire majeur : le 30 Octobre 2025, les gouvernements espagnol et portugais, avec la Commission européenne, ont signé un accord pour la construction de la première liaison ferroviaire directe entre Madrid et Lisbonne, une avancée historique, attendue depuis des lustres qui devrait devenir réalité dans les cinq prochaines années.
Si les étoiles frontalières sont alignées entre l’Espagne et le Portugal, là encore l’histoire et la géographie n’entendent rien céder de leurs prérogatives pour malicieusement glisser un petit irritant entre Lisbonne et Madrid.
C’est dans L’Atlantique, à 160 kms des Canaries et à 250 kms de Madère que se niche ce petit irritant, plus précisément dans les îles Selvagens, chapelet d’une quinzaine d’ilots (2,7 km² de superficie totale, 4 habitants). Sous souveraineté portugaise, érigés en réserve naturelle, ces ilots sont au centre d’une aire marine protégée (AMP) de 2 700 km², soit la plus grande d’Europe. Jusque-là tout va bien, mais les choses se compliquent quelque peu lorsqu’il s’agit de définir l’étendue de la Zone économique exclusive à laquelle donnent droit ces îlots. L’Espagne invoque l’article 121 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et fait valoir que ces « rochers » ne donnent pas droit à une ZEE (Zone économique exclusive) tandis que le Portugal soutient au contraire qu’il ne s’agit pas de rochers mais bien d’ îles » qui permettent l’existence d’une ZEE. Portant sur des enjeux non négligeables (zone de pêche, exploitation minière du fond de l’Océan), cette divergence juridique est gérée bilatéralement et à bas bruit par Madrid et Lisbonne qui s’emploient sagement à éviter d’en faire l’objet d’un contentieux ouvert.
Entre enclaves, penones et presides, les confettis du sud
Sur les rives sud de la mer d’Alboran, l’Espagne détient plusieurs possessions en mer et sur la terre ferme, legs d’une lointaine histoire. Sur la côte africaine, l’Espagne possède deux « Presides », Ceuta (18 km²) et Melilla (12 km²), places fortes espagnoles depuis 1497 pour Melilla et 1580 pour Ceuta. Aujourd’hui peuplée chacune d’environ 80 000 habitants, ces deux enclaves espagnoles entourées par le Maroc font régulièrement l’objet de revendication de souveraineté par Rabat.
Au large des côtes marocaines, l’Espagne possède également plusieurs petites îles :
- Les îles Chafarines, trois îlots à 4 kms des côtes marocaines, sous souveraineté espagnole depuis 1848.
- L’île du Penon de la Gomera, sous souveraineté espagnole depuis 1564.
- L’île du penon d’Alhucemas, formé de 3 îlots et sous souveraineté espagnole depuis 1559.
- Les îlots de La Tierra et du Perejil, respectivement situés à 50 et 200 mètres du rivage marocain.
Tandis que le Maroc rappelle périodiquement ses revendications sur ces différents petits bouts d’Espagne, cette dernière met pour sa part en avant ses droits historiques et fait valoir le principe d’autodétermination au nom duquel les populations de Ceuta et Melilla maintiennent leur volonté de rester sous souveraineté espagnole.
Ce contentieux latent n’empêche pas aujourd’hui le Royaume Chérifien et le Royaume d’Espagne d’entretenir d’excellentes relations et de développer une coopération transfrontalière autour de ces petits territoires dans des domaines aussi sensibles que la lutte contre la criminalité transfrontalière et contre l’immigration irrégulière (essentiellement d’origine sub-saharienne, mais pas que).
Les singes de Gibraltar
Aux carrefours des continents européen et africain, de la méditerranée et de l’Atlantique, le détroit de Gibraltar est dominé par le rocher éponyme (le Penon pour les Espagnols) au sommet duquel flotte l’Union Jack depuis le Traité d’Utrecht de 1713. Depuis lors, l’Espagne n’a eu de cesse de réclamer la restitution de ce petit bout d’Angleterre (6,8 km2, 30 000 habitants). Ce contentieux a donné lieu au fil des ans à des tensions fréquentes autour de la pêche dans les eaux adjacentes, autour de l’accès terrestre au Rocher par la Linea de la Concepcion, ou autour du régime fiscal dont bénéficie Gibraltar. Pour ne pas faire droit aux revendications espagnoles, les Britanniques ont opposé aux Espagnols le même argument que ceux-ci opposent aux marocains, celui du droit à l’autodétermination des populations concernées, lors du referendum de 2002 les habitants de Gibraltar ayant fait le choix à 98,9% pour le maintien dans la Couronne britannique.
Comme les choses ne sont jamais simples, les habitants du Rocher ont été contraints, alors qu’ils y étaient opposés, de subir à leur tour les conséquences du Brexit. La sortie du Royaume Uni de l’UE a conduit les diplomates espagnols, britanniques et la Commission européenne à négocier un accord post Brexit qui a été conclu le 11 Juin 2025. Aux termes de cet accord, aucun des deux protagonistes n’a cédé d’un pouce sur la question de la souveraineté mais ils se sont en revanche accordés sur un certain nombre de dispositions et mesures pratiques et de bon sens visant à faciliter la circulation des biens et des personnes, et à adapter le régime du contrôle des passagers à l’aéroport de Gibraltar.
Le Rocher est donc appelé à rester un objet frontalier et diplomatique complexe. Une légende prédit que les Anglais quitteront Gibraltar le jour ou le dernier des singes qui pullulent aujourd’hui sur les flancs du Rocher aura disparu. Les diplomates britanniques et espagnols semblent donc avoir encore beaucoup de grain à moudre, tandis qu’ils ont fait pour l’heure le choix du bon sens, du pragmatisme et de l’apaisement.
Cette petite virée le long des frontières du Royaume d’Espagne nous montre combien l’histoire et la géographie peuvent se montrer taquines et réserver des surprises lorsqu’elles se conjuguent. Dès lors, si les frontières relèvent du régalien chimiquement pur, leur gestion et celle de la coopération transfrontalière font appel à des équilibres subtils ou l’action des États doit se nourrir et s’enrichir de celle des collectivités territoriales et des sociétés civiles frontalières afin d’être à la hauteur des enjeux et des attentes des bassins de population concernés.
Bernard VALERO
Ancien Ambassadeur, membre du Conseil de Surveillance de l’Union pour la Méditerranée (UpM).