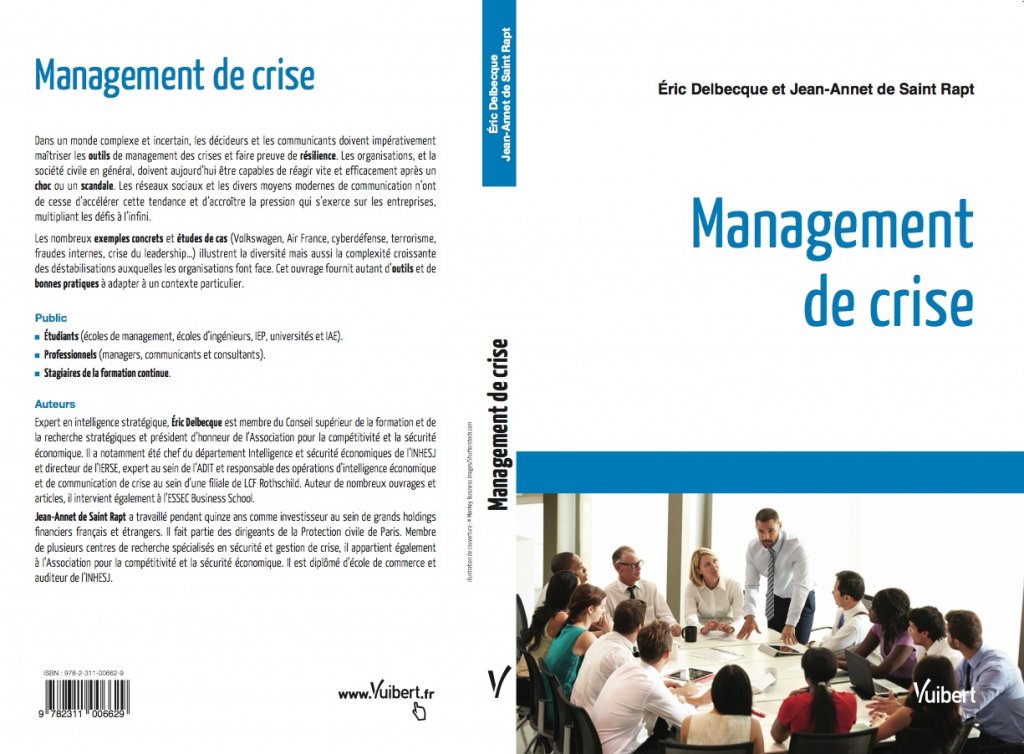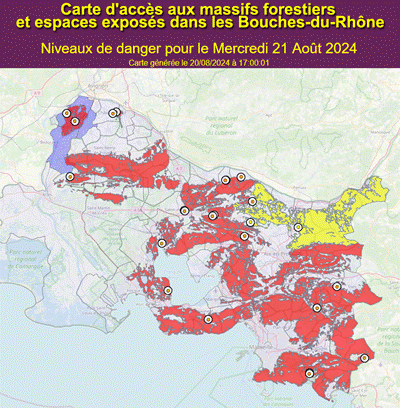Publié le 14 mai 2016 à 13h56 - Dernière mise à jour le 29 octobre 2022 à 13h45
Eric Delbecque, Directeur du département intelligence stratégique de SIFARIS, chef du pôle intelligence économique de l’Institut pour la formation des élus territoriaux (IFET), membre du Conseil scientifique du CSFRS et conférencier au Centre des Hautes Études du Ministère de l’Intérieur (CHEMI), propose une Tribune sur «la notion de crise». Précisant: «L’ensemble des turbulences récentes que traversent notre pays (contestation de la loi travail, jeux politiques multiples préparant l’échéance de 2017, etc.) peuvent être l’occasion de réfléchir à ce qu’est devenue la notion de crise».
La crise n’est plus un mauvais moment à passer : elle est devenue un climat permanent, une culture des individus et des organisations. La crise échappe aux discours strictement universitaires : elle ne constitue pas un objet académique mais une expérience intensément vécue. On ne la connaît pas simplement en l’observant mais en la vivant, puis en la méditant. Elle ne peut être saisie véritablement que par des personnes qui l’ont personnellement, intimement éprouvée. Nous sommes d’ailleurs de plus en plus nombreux à en connaître le visage. D’où l’utilité, pour les hommes et les femmes confrontés à des crises majeures, au sein des organisations, entreprises ou administrations, de participer à des simulations de crise : la toucher du doigt, même au cours d’un exercice, c’est la comprendre plus finement, avec acuité, et se montrer ensuite plus apte à l’assumer et à la dépasser, bref à la manager et à organiser sa propre résilience et celle d’une équipe entière.
Au final, la crise nous déborde deux fois : elle se répand désormais dans le temps et l’espace, puisqu’elle concerne de plus en plus d’individus et d’organisations.
La crise, répète-t-on à longueur de manuels, forme le moment d’un choix, l’instant décisif, l’occasion d’une décision. Sans aucun doute. Mais elle dépasse désormais cette simple caractérisation. Elle ne se conçoit plus sur un mode on/off : celui de sa présence ou de son absence.
Dans le monde actuel, la crise s’avère un état quasi permanent, tout au moins un mouvement sinusoïdal : que l’on se situe sur un point haut, bas ou médian de la courbe de crise, les fondamentaux de la sortie du «temps de paix» apparaissent toujours présents. Ce que je nomme, avec Laurent Combalbert, les circonstances exceptionnelles et conflictuelles offrent le contexte presque continu des initiatives de chacun d’entre nous.
L’incertitude, la complexité de l’environnement global, la multiplication incessante des parties prenantes, la mécanique médiatique, la coagulation d’acteurs hostiles, composent quelques-unes des dynamiques chroniques fabriquant l’état de crise.
Le précédent paradigme de la crise rassurait les esprits et permettait un certain contrôle sur les émotions. Si la crise débute, atteint un pic puis décroît, nous laissant dans le calme pour une période déterminée, généralement assez longue, elle apparaît psychiquement supportable car opérationnellement maîtrisable. Dans ce monde ancien, on l’anticipait, on la calculait puis on la préparait en établissant des procédures à appliquer le moment venu : on pouvait prétendre qu’elle appartenait au métier de l’assureur. Elle correspondait à l’univers de sens de la mobilisation et de la prévoyance. Comme dans une guerre que l’on voit venir, on planifie les moyens et on les active une fois le «gros temps» venu.
Ce schéma ne fonctionne plus. Si l’on accepte de définir la crise comme une sortie hors des routines, des modes de fonctionnement ordinaires d’un individu ou d’une organisation, en raison de l’impact d’un événement ou d’une série d’événements, alors il faut accepter que nos modes d’existence et d’action au quotidien échappent de plus en plus à des normes fixes et rassurantes. La crise cristallise parallèlement un climat hautement conflictuel et focalise la sphère médiatique. Pour reprendre le titre extrêmement adapté à l’époque de l’avant-dernier livre de Luc Ferry (en référence à la théorie de la « destruction créatrice » de Schumpeter), L’innovation destructrice [[Plon.]] règne : elle nous bouscule à chaque instant, n’admet pas de répit.
Arrêtons-nous quelques instants sur sa thèse, laquelle éclairera la nôtre.
Il déploie dans les pages de ce petit texte vigoureux toutes les conséquences de l’idée de croissance schumpétérienne, laquelle se distingue de la croissance keynésienne. Cette dernière «procède de l’augmentation du nombre des consommateurs et, si possible, de l’épaisseur de leur portefeuille». La vision schumpétérienne «tient que le vrai moteur de la croissance est l’innovation qui rend peu à peu obsolètes tous les reliefs du passé, qu’il s’agisse de produits, de modes de vie ou d’organisations techniquement dépassées». Effectivement, celle-ci tend à prendre le pas sur la première (keynésienne) dans la mesure où le pouvoir d’achat favorisait des firmes de pays qui ne soumettent pas aux règles en vigueur sur le continent européen.
Il ne faut pas pour autant, explique Ferry, sombrer dans l’anticapitalisme primaire ou «de salon», car cette dynamique de l’innovation permanente portée par le libéralisme économique fit très largement ses preuves. «Pour dire les choses simplement, dans l’histoire de l’Europe capitaliste, notre espérance de vie a été pratiquement multipliée par trois depuis la fin du XVIIIe siècle, et notre niveau de vie moyen par vingt ! Pour prendre un point de repère plus proche, notre pouvoir d’achat a triplé depuis les années 1950».
Certes, la logique de l’innovation engendre de la flexibilité, et donc de l’insécurité, pour les salariés. Il n’en reste pas moins qu’elle produit également des effets positifs. Au cœur de l’hypercompétition mondiale, l’innovation impose une vigilance de tous les instants, une aptitude aigüe à la veille et favorise les individus formés capables de produire de la connaissance.
D’où une conclusion lucide de l’auteur : «Il s’agit enfin de comprendre que ce n’est pas une simple “crise” momentanée que nous vivons, mais une révolution permanente qui ouvre des perspectives sans doute enthousiasmantes pour ceux qui “gagneront”, mais infiniment angoissantes pour les autres, pour ceux qui sont attachés à leur petit espace de vie, à leur pré carré, à leur coin de province ou à leurs statuts en voie d’extinction, et qui, on peut et on doit le comprendre, ne perçoivent que les effets délétères du capitalisme dans leurs existences bouleversées».
Les mots employés par Luc Ferry s’avèrent d’une clarté totale et font signe vers l’univers sémantique de la guerre économique : «Comme une espèce animale qui ne s’adapte pas est «sélectionnée» dans le monde de Darwin, une entreprise qui n’innove pas sans cesse est vouée à disparaître, à être avalée par le voisin. Il ne s’agit plus de viser la liberté et le bonheur, de travailler au progrès humain, comme un philosophe du XVIIIe siècle pouvait encore le croire, mais tout simplement de survivre, de se battre et de “gagner” dans un monde de compétition devenu féroce». Autant d’éléments qui donnent une force d’évocation certaine à sa formule d’«innovation destructrice», laquelle souhaite assumer la double nature du changement : créatrice de possibles et négatrice de mœurs, traditions et modèles anciens.
Ce que Luc Ferry démontre de manière limpide, c’est la conjonction entre le libéralisme économique le plus radical et la pensée moderniste la plus brutale. Pour illustrer son raisonnement, il explore de façon extrêmement convaincante la convergence sur le fond entre l’art contemporain et le capitalisme d’aujourd’hui. S’appuyant sur les écrits de Kandinsky, le fondateur de l’art abstrait, il démontre que l’innovation destructrice réunit le bourgeois et le bohème, donnant naissance au «bobo»… «Comme Picasso ou Duchamp, notre bourgeois pratique désormais la table rase et l’innovation radicales. Au nom du benchmarking, il doit révolutionner sa firme sans répit. Ce qui donne parfaitement raison à Marx autant qu’à Schumpeter. Le capitalisme, c’est bel et bien la révolution permanente, l’innovation destructrice à jet continu».
Aujourd’hui, la crise s’inscrit exactement dans ce paysage conceptuel et concret que dessine Luc Ferry. Le monde se détruit et se recrée à chaque instant, en laissant quelques décombres fumants, et en pulvérisant bien des repères. Voilà ce que le mot «crise» signifie profondément.
La stratégie comme réponse
Dans ce contexte, il nous faut entrer en stratégie comme on entre en religion… C’est une conversion totale du regard et du comportement qui nous est demandé par le monde qui nous entoure. Parce que la crise définit le monde contemporain, et qu’elle désigne une mise sous tension de chaque instant, une accélération permanente, une exacerbation des modes relationnels conflictuels, le tout dans un monde chaotique, incertain, cimenté par des interdépendances multiples aux résultats relativement imprévisibles (au-delà d’hypothèses élémentaires), elle appelle naturellement le secours du raisonnement stratégique. La crise requiert fatalement la stratégie.
A cet égard, le monde militaire nous enseigne ce que nous avons à savoir sur le modèle stratégique de réflexion. Le général Beaufre définissait la stratégie comme une action finalisée en milieu conflictuel. Nous évoluons aujourd’hui dans un monde (notamment économique) par définition conflictuel, tout simplement parce qu’il est hautement concurrentiel. Cette concurrence s’avère plus ou moins forte, plus ou moins licite, elle prend des formes différentes au fur et à mesure que le temps passe. Mais force est de constater que nous évoluons dans un état de tension permanent. Certes, il existe des moments de coopération, que dans un langage plus martial on appellerait des trêves.
Mais globalement, le contexte auquel nous faisons face sans repos s’impose par essence comme incertain et périlleux. De fait, la stratégie est justement élaborée pour donner des caps à tenir dans ces périodes d’incertitude. Ce qui diffère de la planification, rigide, qui définit les objectifs que l’on s’assigne au sein d’un monde fermé dont on connaît et contrôle tous les paramètres. La planification joua pleinement son rôle au cours des Trente Glorieuses, mais c’est maintenant la stratégie qui reprend ses droits à l’heure de la globalisation.
Or, il se trouve que la plupart des organisations humaines -par faiblesse, aveuglement ou facilité- passent difficilement d’un cadre mental à l’autre, et ne se donnent pas forcément les moyens d’opérer cette mutation de la planification vers la stratégie. Cela vaut pour les individus, les entreprises, mais aussi à l’échelon national comme au niveau des territoires, et peut-être plus encore à l’échelon européen. La stratégie nous pose collectivement problème…
Un autre élément exige d’être pris en compte. Pour faire de la stratégie, il faut se donner du temps. Il faut réapprendre à penser sur le moyen ou le long terme, ce que nous ne savons plus faire puisque nous sommes englués dans une vision court-termiste des situations, des choses et des êtres, laquelle paralyse notre capacité à raisonner véritablement. Dans le très court terme, on se contente -dans le meilleur des cas- de faire de la tactique. Cette dimension a envahi l’ensemble de la société, à tous les niveaux, dans le public comme dans le privé. On comprend bien qu’en un temps où, pour une multitude de raisons, chacun se borne simplement à essayer de gérer au mieux son lendemain, il devient presque impossible d’engager une réflexion -pourtant indispensable- sur le devenir d’individus ou de collectivités à cinq, dix ou vingt ans.
La crise semble dès lors aux antipodes de la stratégie. Cette dernière paraît s’épanouir dans le calme et la réflexion, l’anticipation, alors que la crise se conduit dans l’urgence, le stress, la réaction et l’instinct. Pourtant, c’est précisément le paradoxe qu’il s’agit de résoudre : c’est au plus fort de la crise, que le mode stratégique de réflexion et d’action doit prévaloir, tout en acceptant les apports de l’intuition et de la pression. Exploit délicat qui demande un gigantesque travail, de l’ascèse, de la volonté, une forte introspection, beaucoup d’intelligence du monde et de l’entraînement.
Un défi à relever
«Il faut bien reconnaître que personne aujourd’hui, homme de gouvernement, théoricien de la science politique ou économique, n’est capable d’embrasser la complexité créée par le développement très rapide des connexions de toute nature sur le globe, et de prévoir les retentissements à très brève échéance des événements. Tout acte, pour raisonné qu’il soit, équivaut à un coup de dés [[Valéry Paul, Vues. Paris, Editions de La Table Ronde, 1948.]]». Ce constat que faisait Paul Valéry, voilà plus de soixante ans, s’avère frappant de lucidité et de modernité ! Cet écrivain prophétique du XXe siècle décelait déjà les «signaux faibles» de la mondialisation, diagnostiquait l’interdépendance caractéristique de notre temps (le sens profond du terme de globalisation), et mettait ainsi le doigt sur le moteur même des «crises» : à savoir les chaînes d’interactions qui échappent rapidement à la compréhension et à l’action efficace.
En revanche, la caisse de résonance médiatique et le caractère foudroyant de la transmission instantanée de l’information en chaque point de la planète manquaient à son époque ! Cette nouveauté participe de la pleine définition de ce que représente aujourd’hui une crise. Nous le précisions plus haut : celle-ci reste une chose délicate à cerner. Certes, elle semble envahir notre quotidien. Nous voyons des crises partout : crise économique bien sûr mais aussi, crise politique, crise des valeurs, crise de civilisation ou crise du couple ! On constate ainsi que le spectre est large : les utilisations de ce mot sont légion.
De manière plus fine et essentielle, répétons-le la crise (qui ne se déploie plus sur un schéma on/off) désigne les moments où les organisations (publiques ou privées) ne parviennent plus à s’adapter à leur environnement, à maîtriser des événements et des situations en recourant aux «routines», c’est-à-dire aux procédures prédéfinies qui orientent l’action et le comportement général d’une collectivité humaine poursuivant une finalité particulière (notamment les entreprises ou les administrations). On peut synthétiser le diagnostic de la manière suivante : «Une crise ne débute pas à un instant précis pour s’achever à un autre, tout aussi précisément situé dans le temps.
Elle relève davantage d’un modèle sinusoïdal : elle connaît des pics et des points bas sans commencer soudainement et se clore brutalement. Disons plutôt qu’elle “monte” comme une vague, enfle comme une rumeur, puis s’envole vers des paroxysmes ponctués de reflux plus ou moins inattendus, avant de décroître progressivement, sans cesser de former des braises prêtes à se rallumer (le rebond de crise) si le vent se lève ou que du “combustible” se présente [[Combalbert Laurent & Delbecque Eric, La gestion de crise. Paris, PUF, 2012.]]» …
Il s’agit dès lors de savoir observer, innover et réagir vite pour demeurer en situation de ne pas totalement subir un chainage événementiel complexe, anxiogène et mettant rapidement en place un environnement d’action fortement dégradé.
Bien entendu, la crise se caractérise également par une extrême focalisation médiatique. Cette dernière participe de la montée aux extrêmes en permettant à différents acteurs de s’agréger d’une manière ou d’une autre (en facteur «aggravant» ou «désamorçant») à la spirale de crise.
Les origines des crises sont multiples et se classent habituellement à travers les grilles des cartographies des risques. Il importe donc de connaître à la perfection l’échiquier sur lequel on mène sa partie.
Mais surtout, la crise, comme la guerre, tire de l’homme l’essentiel, ce qui le constitue au cœur de son être. Dans un livre stimulant [[Sous le feu. La mort comme hypothèse de travail. Paris, Tallandier, 2014.]], Michel Goya structure fortement son raisonnement avec une idée clef, qui vaut pour le management de crise comme pour l’art de la guerre. «Le combat n’est pas un phénomène “normal”, c’est un événement extraordinaire et les individus qui y participent ne le font pas de manière “moyenne”. Comme un objet à très forte gravité qui déforme les lois de la physique newtonienne à son approche, la proximité de la mort et la peur qu’elle induit déforment les individus et étirent leur comportement vers les extrêmes. La répartition des rôles n’y obéit pas à une loi de Gauss où tout le monde ou presque agirait de manière à peu près semblable, mais à une loi de puissance où, entre l’écrasement et la sublimation, beaucoup font peu et peu font beaucoup».
Cette épreuve de l’extrême est certes fondamentale pour comprendre les militaires contemporains et les défis auxquels ils font face, ainsi que pour tenter d’imaginer ce qu’ils peuvent ressentir et penser sur un théâtre d’opérations. Mais le propos de Michel Goya intéresse également la société civile et plus encore l’univers de l’entreprise quand il fait face à une crise. Dans le climat d’hyper-concurrence généralisée que nous connaissons, ses conclusions présentent un intérêt pour l’ensemble des dirigeants d’organisations, par exemple lorsqu’il rappelle la place centrale de l’expertise du chef, et tout autant de ses qualités personnelles, dans la préservation des équipes et la continuité d’activité.
Pour le dire de manière encore plus brutale, comme nous l’enseignent aussi les conflits, la crise nous apprend que la préparation des personnalités compte encore davantage que l’application des procédures dans l’anticipation, le pilotage et la sortie des crises… Stratégie et résilience : les deux piliers du chef et de son équipe dans la tourmente… Conduire la crise, c’est entraîner des personnalités, dans tous les sens du mot, en amont et en aval, afin qu’ils soient pleinement eux-mêmes au moment de la crise…
Pour entrer au cœur de notre sujet, les lignes suivantes se révèlent particulièrement inspirantes : «Tout héros qui voyage ou combat possède nécessairement le sens de l’effort et de l’épreuve, il connaît la solitude et l’endurance, sans quoi la maturation personnelle est inexistante, sans quoi il reste un errant à l’orée de la quête. L’élan initial, le désir de cheminer doivent persister au milieu des difficultés. La noblesse du héros ne consiste pas à réussir mais à ne jamais abandonner. Le vocabulaire d’une époque est toujours instructif : dans notre société moderne, on entend parler presque uniquement de “problèmes” et on s’emploie à les résoudre. Or dans le monde initiatique et spirituel qui est celui du héros il n’y a jamais de problèmes, il y a des épreuves. Le problème est à régler, l’épreuve demande à être traversée».
En effet, toute la question est là… La crise fut toujours perçue comme un seuil, une transition. Elle semble aujourd’hui devenir notre Destin, notre état permanent, individuel et collectif, c’est pour cela qu’elle mobilise tant nos esprits… C’est une épreuve qui dure à perte de vue… En tout état de cause, il faut plus que jamais envisager la crise comme une occasion de dépassement où la lucidité, la maîtrise de nous-mêmes constitue le plus important facteur critique de succès : «Un héros n’a jamais de problèmes psychologiques, c’est sur un autre plan qu’il affronte le monde et ses terres intérieures. Un problème réglé entraîne le soulagement, la sécurité (même illusoire) ; l’épreuve offre une occasion de grandir, de se découvrir, de se transformer.» Et en soi l’épreuve est signe d’élection : «Les grandes tempêtes sont pour les grands navires, disait Kazantzákis. Chaque homme n’a pas la chance, durant son existence, de rencontrer un Minotaure, de poursuivre une biche aux yeux d’airain, de s’enfoncer dans la forêt obscure ou de pleurer de désespoir devant un château fermé. Le danger, le combat, la solitude, la maladie, le deuil n’apparaissent au héros ni comme des problèmes, ni comme des échecs, ni même comme des obstacles à la poursuite du voyage : ils font intégralement partie du voyage, ces sont des portes à traverser pour connaître ses vraies dimensions -spirituelles, non psychologiques ni physiques -, pour rencontrer tout au bout son vrai visage. Et la mort du héros ne veut pas toujours dire qu’il a épuisé toutes les épreuves [[Kelen Jacqueline, L’éternel masculin. Traité de chevalerie à l’usage des hommes d’aujourd’hui. Paris, Robert Laffont, 1994.]] » …
Ne cherchons pas en vain un monde stable : il n’existe pas à l’horizon que l’œil humain peut discerner. Il convient plutôt de se résoudre à accepter que la «crise» caractérise ce siècle et sert simplement à nommer les circonstances exceptionnelles et conflictuelles qui tissent dorénavant notre ordinaire, devenu l’extra-ordinaire permanent. L’insolite et l’imprévu, l’inconnu et le pas-encore-vu, le non répertorié, nous tiennent lieu de banal, ou plutôt d’habituel… Il importe donc d’y accoutumer les caractères et d’en faire une occasion de dépassement et de progrès…