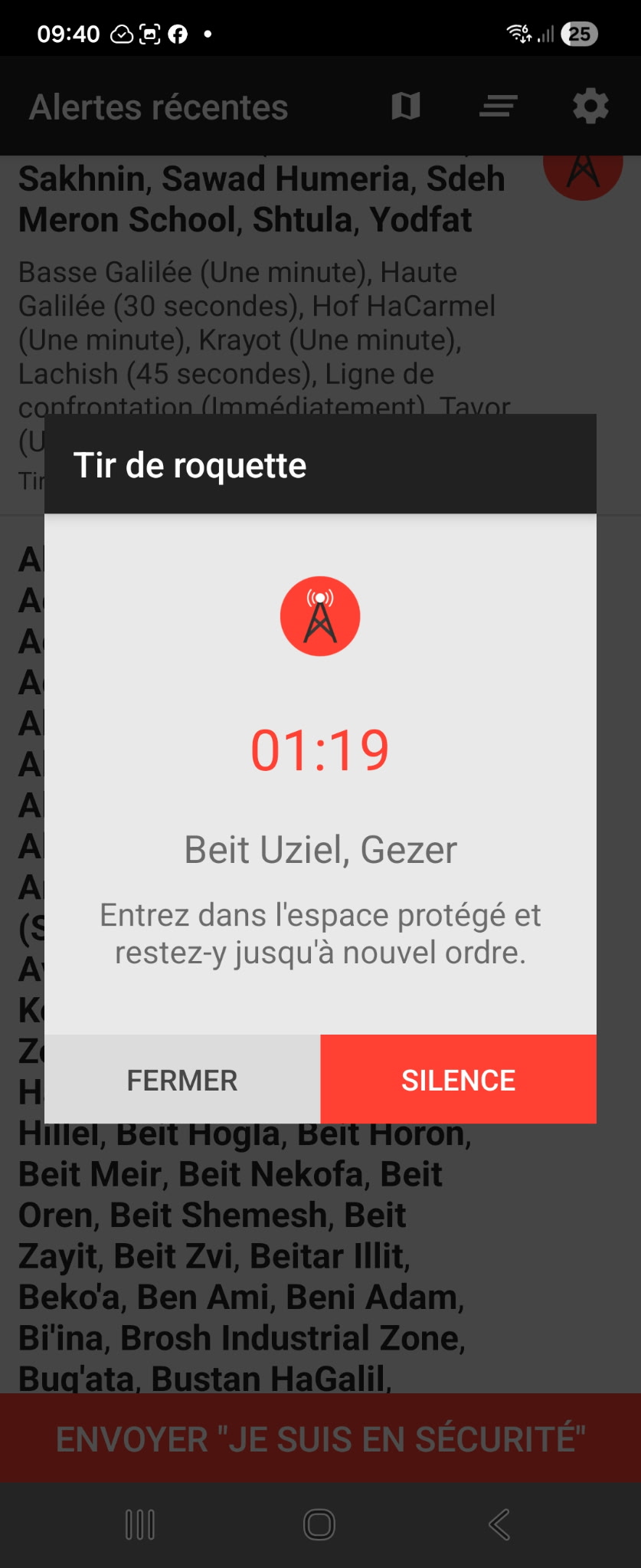Don Giovanni et ses conquêtes féminines détruites, Billy Budd, beau marin pendu, victime de la jalousie, Louise, jeune fille à la vie brisée par un environnement familial toxique, Calisto, nymphe abusée par Jupiter : quatre œuvres actuellement jouées à Aix-en-Provence, quatre regards sur la société.
Lors de la présentation de l’édition 2025 le 30 janvier dernier, Pierre Audi, le directeur du Festival d’Aix-en-Provence, disparu le 3 mai et auquel un émouvant hommage a été rendu il y a quelques jours, soulignait et publiait dans l’avant-programme : « Si les œuvres programmées cette année montrent avec une certaine constance la violence destructrice du désir contre l’objet du désir, si elles font traverser cette zone brumeuse dans laquelle l’humanité peut perdre ses repères les plus fondamentaux, elles indiquent tout de même aux plus vulnérables le ciel étoilé d’une possible émancipation. » Don Giovanni est mort d’une crise cardiaque, Billy Budd a été mangé par les poissons, Louise accompagnée de ses parents, poursuit ses séjours en psychiatrie… En fait, la seule à s’être vraiment émancipée, c’est la Calisto qui, avant de devenir étoile au firmament, s’est offert le plaisir d’enfoncer une aiguille dans le cœur de Jupiter, celui qui avait causé son malheur en tant que nymphe avant de la faire briller dans le ciel. Quatre productions festivalières artistiques fortes.
L’agonie de Don Giovanni

Au Grand Théâtre de Provence, la mise en scène de l’opéra de Mozart par le britannique Robert Icke, qui aborde ici pour la première fois un ouvrage lyrique, n’a pas fait l’unanimité. Il faut dire que le fait d’instaurer rapidement une fusion-confusion entre le libertin et le commandeur brouille la compréhension et que le spectateur, peu au fait du livret, aura du mal à s’y retrouver. L’action est installée dans un sous-sol noir et sinistre surmonté d’une installation de trois boxes délimités par des rideaux, tour à tour, et entre autres, appartement de Don Giovanni, chambre de réanimation, chambre de Dona Elvira et chambre mortuaire ! Dans cet environnement, Icke fait évoluer un Don Giovanni sous perfusion, entre agonie et démence, a moins que ce ne soit la vie du commandeur qui défile au moment où il vient de faire une crise cardiaque. Bref, on s’y perd un peu, beaucoup, mais à la folie on aime la musique et les voix.
Dans la fosse, Sir Simon Rattle dirige avec élégance un orchestre de la Radio Bavaroise aux couleurs somptueuses et totalement engagé pour livrer le meilleur Mozart possible. Sur scène, André Schuen incarne ce Don Giovanni si particulier, investi dans son rôle physiquement, ce qui est une vraie performance au regard des exigences du metteur en scène, et vocalement avec ligne de chant précise et projection idéale. Le Leporello de Krzysztof Baczyk est lui aussi sombre à souhait, vocalement tout en puissance maîtrisée, à la fois distant et en empathie pour Don Giovanni. L’Elvira de Magdalena Kozena incarne, la présence la plus humaine du drame, déchirante souvent, alors que la Donna Anna de Golda Schultz peine quelque peu à affirmer son personnage dans ce puzzle sentimental même si vocalement elle séduit. Le Don Otavio d’Amitai Pati reste en retrait malgré une agréable ligne de chant tout comme Clive Bayley, commandeur relégué au rang des vivants sans effets de graves et de puissance. La Zerline de Madison Nonoa est sensuelle et juvénile, mais sans éclats aux côtés d’un Masetto incarné avec aisance par Pawel HorodyskI. Quant au Chœur de chambre philharmonique d’Estonie, il est totalement en place.
Billy Budd, création triomphante

Au Théâtre du Jeu de Paume, la création mondiale de « The story of Billy Budd, sailor » a déchaîné les passions, faisant se lever d’un coup d’un seul toute la salle aux saluts. Ovation méritée au regard de l’intelligence du travail de Ted Huffman et Oliver Leith qui ont imaginé cet opéra de chambre d’après l’opéra éponyme de Benjamin Britten. Billy Budd est beau, généreux, travailleur, respectueux, homosexuel et bègue lorsque l’émotion le submerge. Dès son embarquement, le capitaine d’armes John Claggart, être brutal et malfaisant, mettra tout en œuvre, et notamment la trahison du novice, le compagnon de Budd, pour l’éliminer en l’accusant faussement de pousser l’équipage à la mutinerie. Devant Vere, le capitaine du navire, Billy Budd sera dans l’incapacité de se défendre, pris par le bégaiement, et frappera involontairement Claggard, le tuant sur le coup. Même persuadé de l’innocence de Budd, Vere laissera la justice militaire, faire son travail et condamner le jeune marin à la pendaison devant l’équipage.
Huffman et Leith, signent ici une œuvre qui n’élude aucune des vicissitudes de la vie, jalousie et haine en tête. L’approche scénique minimaliste – une cage de scène nue pour toute immensité de l’océan, un praticable en guise de pont de navire – et le travail effectué sur le texte pour aller à l’essentiel sont totalement réussis et procurent une réelle intensité dramatique. Claviers, percussions et synthétiseur, sous la direction de Finnegan Downie Dear, livrent une partition puissante et colorée. Ian Rucker est un idéal Billy Budd, ligne de chant précise, aigus maîtrisés et sensibilité omniprésente ; la séduction n’a aucun mal à s’opérer. Joshua Bloom a la particularité d’être successivement le détestable Claggart et l’amical Dansker. Il passe de l’un à l’autre sans aucun problème, modulant sa voix de basse, sombre, et la puissance de sa projection en fonction de son jeu sur scène. Quant à Christopher Sokolowski (Vere et Squeak) lui aussi fait preuve d’assurance avec un chant limpide, direct, aigus parfaits et grande sensibilité. Un trio d’exception auquel se sont joints avec bonheur trois chanteurs issus de la résidence voix de l’Académie 2025 du Festival, le ténor Hugo Brady et les barytons Noam Heinz et Thomas Chenhall, pour incarner les autres rôles.
Louise, destin brisé

Dans l’opéra de Gustave Charpentier, Louise est une jeune fille étouffée par la cellule familiale toxique qui s’émancipera en rejoignant son amoureux, le poète Julien. Au théâtre de l’Archevêché où l’on donnait pour la première fois de l’histoire une œuvre du compositeur français, Christof Loy, le metteur en scène a fait un autre choix sans émancipation puisque dans le décor unique, une salle d’attente froide et impersonnelle d’un hôpital psychiatrique, il installe l’héroïne du début à la fin comme si elle vivait ici un rêve de jeune fille sous le regard, et le contrôle, d’un père certainement incestueux et d’une mère diaboliquement jalouse et méchante. Quant au poète montmartrois il s’avèrera être, in fine, le médecin traitant de Louise. C’est un rôle titre en or massif pour Elsa Dreisig, la soprano franco-danoise qui revient à Aix-en-Provence trois ans après son triomphe avec « Salomé ».
Elle convainc, séduit, émeut, maîtrisant son jeu et livrant une prestation vocale de haut vol avec un engagement total. Elle est aussi crédible en jeune fille renfermée et fragile qu’en muse de Montmartre libérée, adaptant, comme ses costumes, les couleurs et la puissance de sa voix aux situations qui sont les siennes. A ses côtés, Julien est incarné par le ténor Adam Smith avec une belle présence scénique – souvent un peu trop agitée – et des aigus ayant du mal a être maitrisés.
Dans le rôle de la mère méchante et jalouse, Sophie Koch impose son savoir-faire tant scénique que vocal procurant toute sa dimension négative à son personnage. En père possessif et toxique, un rôle qu’il maîtrise totalement, Nicolas Courjal, sombre voix de basse et vibrato parfois trop présent, est impressionnant dans son accès de démence du dernier acte. De la pléiade de seconds rôles, dont il est difficile ici de mettre en avant telle ou tel, jusqu’aux membres du chœur de l’Opéra de Lyon et aux enfants de la Maîtrise des Bouches-du-Rhône, l’homogénéité dans la qualité a permis à chacune et chacun d’assurer l’intérêt des interventions en solistes ainsi que des ensembles. Dans la fosse, pour servir ce roman musical aux riches couleurs et aux accents originaux, l’orchestre de l’Opéra de Lyon placé sous la direction attentive et précise de Giacomo Sagripanti propose une interprétation équilibrée et nuancée de cette partition qui préfigure, à l’aube du XXe siècle, l’évolution de l’opéra en France.
La Calisto, étoile scintillante

Avec le dramma per musica de Francesco Cavalli, une fois de plus, le répertoire baroque offre au Festival d’Aix-en-Provence un motif de satisfaction. Et le public ne s’y est pas trompé ovationnant les artistes à l’issue d’une première représentation donnée dans la fraîcheur d’une soirée avec mistral… La Calisto, c’est l’histoire d’une nymphe dévouée à Diane qui refuse les relations avec les hommes. Elle est abusée par Jupiter travesti sous les traits de la déesse de la chasse, puis transformée en ourse par Junon jalouse et promue in fine en constellation scintillante. Une intrigue revisitée par la metteuse en scène Jetske Mijnssen accablant en premier lieu, et à juste titre, Jupiter, pervers et manipulateur qui ne l’emportera pas au paradis puisque la Calisto, avant de s’élever vers la voûte céleste, lui transpercera le cœur à l’aide d’une longue aiguille à cheveux. Quant à Diane, promise à la chasteté, elle connaitra l’amour en compagnie d’Endymion… Décors et costumes « grand siècle » sont de sortie pour une élégante mise en scène un peu trop éloignée cependant du côté cru d’un livret qui ne manque pas d’érotisme. Dans le rôle-titre, Lauranne Oliva excelle, sensible et splendide Calisto au jeu soigné et à la ligne de chant agréable. Alex Rosen s’impose avec puissance en Jupiter, réussissant aussi sa partie travestie avec une voix de fausset maitrisée. La Diane de Guiseppina Bridelii fait preuve de noblesse et l’Endymion de Paul-Antoine Bénos-Djian excelle en amoureux transi.
Anna Bonitatibus impressionne dans son magistral air de l’acte III, voix chaude emplie d’émotion et de puissance. Dominic Sedgwick est un Mercure avec de faux airs de Leporello, David Portillo, Théo Imart et Douglas Ray Williams complétant idéalement une distribution très impliquée et visiblement très unie autour de cette production et de ses maître et maîtresse d’œuvre. Un beau travail de troupe. Puis il y a la partition, recomposée pendant plusieurs mois pour grand orchestre par Sébastien Daucé, le directeur musical de l’Ensemble Correspondances qui, sous sa direction magnifie trois heures durant une partition à l’indéniable richesse, emplie de nuances et de couleurs. Du pur plaisir.
Michel EGEA
Plus d’informations et réservation sur festival-aix.com